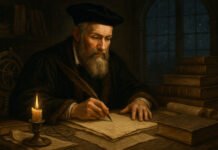Il suffit souvent d’un contexte ou de facteurs sociaux et économiques pour qu’une société se tourne vers un leader charismatique prétendant incarner son salut. L’Histoire du XXe siècle regorge d’exemples où la lassitude, la pauvreté ou la peur ont poussé des populations à soutenir des régimes autoritaires. Il serait tentant de croire que ces dérives appartiennent uniquement au passé. Pourtant, les parallèles entre le fascisme italien, le nazisme allemand et la trajectoire de Donald Trump aux États-Unis montrent que certains schémas se reproduisent sous des formes parfois insoupçonnées.
Cette chronique a pour objectif de décortiquer, de la manière la plus complète et détaillée possible, la montée de Benito Mussolini dans l’Italie d’après 1918, celle d’Adolf Hitler dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, ainsi que l’ascension – puis le retour au pouvoir en 2025 – de Donald Trump aux États-Unis. Vous y trouverez les explications historiques et politiques qui ont permis à ces trois figures de s’imposer, mais aussi les méthodes qu’elles ont employées pour contrôler la société et faire taire l’opposition.
L’Italie fasciste et l’Allemagne nazie restent, pour beaucoup, les symboles ultimes de la dictature. Mais les récentes évolutions américaines, symbolisées notamment par l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, par la réélection de Donald Trump en 2024 et par les mesures radicales prises depuis son investiture du 20 janvier 2025, rappellent combien la démocratie peut se montrer vulnérable, y compris dans des nations qui se considèrent comme des phares de la liberté. Cette analyse mettra en avant la tentation de la censure, le licenciement de masse de fonctionnaires, l’intimidation des journalistes, l’influence croissante sur la culture et la recherche scientifique, ainsi que les manipulations orchestrées via les réseaux sociaux de plus en plus concentrés entre quelques mains influentes.
Nous verrons comment Mussolini, ex-socialiste devenu partisan d’un nationalisme exacerbé, a su dévoyer le régime libéral italien, et comment Hitler, nourri par la crise et le ressentiment de l’Allemagne post-Versailles, a profité d’un cadre légal pour imposer sa dictature. Nous découvrons en parallèle comment Donald Trump, après un premier mandat (2017-2021) déjà marqué par des polémiques, a intensifié ses méthodes lors de son retour au pouvoir : éviction des opposants, censure dans l’enseignement et la recherche, apologie de la violence, et soutien des propriétaires de réseaux sociaux déterminants. L’idée n’est pas d’assimiler automatiquement les trois hommes, mais de mettre en lumière des similitudes frappantes dans le déploiement d’une propagande efficace et d’une mainmise progressive sur les institutions.
La question demeure : la population américaine, comme l’ont été la population italienne et allemande avant elle, est-elle prête à accepter ces dérives ? L’histoire offre de nombreuses leçons. En les étudiant, il devient possible d’identifier les signes avant-coureurs d’une dégradation de la démocratie et, surtout, de ne pas répéter les erreurs qui ont jadis amené certains régimes à sombrer dans l’autoritarisme.
L’Italie de l’après-guerre : l’avènement de Mussolini

La figure de Benito Mussolini occupe une place centrale dans l’histoire du XXe siècle. Ancien militant socialiste, Mussolini se radicalise et fonde, en 1919, les Faisceaux italiens de combat. À cette époque, l’Italie sort meurtrie de la Première Guerre mondiale. Son statut de vainqueur n’a pas comblé les attentes territoriales d’une population qui se sentaient flouées par les traités internationaux. Le pays est en proie à une crise économique et à d’intenses conflits sociaux. Les grèves se multiplient, les affrontements opposent régulièrement les ouvriers et les grands propriétaires.
Mussolini perçoit parfaitement le soif d’ordre d’une frange de la population, exaspérée par l’instabilité politique. Son mouvement, rapidement rebaptisé Parti national fasciste, use d’actions violentes pour détruire les organisations ouvrières et paysannes. Les « chemises noires » menacent, agressent et assassinent des militants de gauche ou tout opposant jugés dangereux. Malgré ce climat d’ultra-violence, un grand parti des élites libérales et du roi Victor-Emmanuel III croit pouvoir exploiter Mussolini pour endiguer la poussée socialiste.
En octobre 1922, la « Marche sur Rome » n’est pas, à parler strictement, un coup d’État militaire. Elle se présente comme une démonstration de force, une menace qui suffit à faire céder le gouvernement libéral. Le roi nomme Mussolini président du Conseil (équivalent de Premier ministre). Très vite, les principes de la démocratie italienne sont foulés aux pieds. Les libertés individuelles, l’indépendance des médias, la légalité parlementaire : tout est progressivement mis au service du parti fasciste. Le Duce se construit un culte de la personnalité, exalte la grandeur passée de Rome et prétend redonner à l’Italie une place dominante dans le monde méditerranéen.
Ce régime fasciste devient un laboratoire d’idées pour d’autres mouvements autoritaires. Mussolini montre comment s’emparer du pouvoir avec une base militante violente et déterminée, comment instrumentaliser la peur du désordre social, et comment museler la presse. Cette expérience marquera profondément Adolf Hitler, dont l’ascension en Allemagne s’opérera une décennie plus tard.
L’Allemagne entre crise et ressentiment : la trajectoire d’Adolf Hitler

Le cas de l’Allemagne est souvent étudié pour comprendre la manière dont un régime totalitaire peut émerger légalement d’une démocratie en crise. Après la Première Guerre mondiale, le pays est déchiré par des problèmes économiques et politiques. Le Traité de Versailles, considéré comme injuste et humiliant par beaucoup d’Allemands, impose de lourdes réparations à la jeune République de Weimar. L’hyperinflation des années 1920, puis la violente crise de 1929, font exploser le chômage.
L’inexpérience démocratique de la République de Weimar et les difficultés économiques créent un terrain propice à l’émergence de discours extrêmes. Adolf Hitler, à la tête du Parti national socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), fait de l’antisémitisme et du nationalisme ses chevaux de bataille. Son influence reste initialement marginale, avec seulement 2,6 % des voix lors des élections de 1928. Mais quand la crise se généralise, sa popularité grimpe en flèche.
Hitler n’a pas besoin d’un putsch militaire pour prendre le pouvoir. Le précédent putsch de la Brasserie à Munich, en 1923, a échoué et l’a conduit en prison. Il en a tiré la leçon qu’il valait mieux accéder légalement au sommet de l’État. En 1933, les conservateurs allemands, persuadés de pouvoir contrôler Hitler, le font nommer chancelier. Rapidement, il évince ses adversaires, exploite des décrets d’urgence pour maintenir les libertés individuelles, et installe une dictature totalitaire.
À la différence de Mussolini, qui se revendiquait d’un régime autoritaire non raciste à l’origine (même si la réalité a vite démenti ce point), Hitler fonde son État sur une idéologie raciale manifestement violente. Les Juifs, les marxistes et les opposants politiques deviennent la cible d’une répression systémique. Des autodafés de livres sont organisés, la presse est uniformisée, l’éducation et la culture doivent désormais glorifier la race aryenne. Les « criminels de novembre », comme Hitler appelle ceux qui ont signé l’Armistice de 1918, sont voués aux gémonies. L’ombre de la guerre ce pointe déjà.
Donald Trump, premier mandat : la promesse populiste (2017-2021)

Lors de l’élection américaine de 2016, beaucoup d’observateurs sont surpris par la victoire de Donald Trump. Homme d’affaires et star de la téléréalité, il se présente en outsider face à une élite politique qui dénonce comme corrompue et déconnectée du peuple. Son slogan, « Make America Great Again » (MAGA), fait écho à des promesses de renouveau national, de protectionnisme économique et de regain de fierté pour une partie de la population blanche ouvrière et rurale.
Si le contexte n’a rien de comparable à la crise de l’entre-deux-guerres, Trump sait manipuler les peurs contemporaines : menace terroriste, immigration illégale, délocalisations industrielles, etc. Il attise la polarisation autour de sujets sensibles, bouleversant les conventions politiques traditionnelles. Il s’en prend violemment aux médias, qualifiés de « fake news » dès qu’ils lui sont défavorables.
Son premier mandat, entamé en janvier 2017, est ponctué de polémiques : mise en œuvre partielle des restrictions migratoires (le fameux « Muslim Ban »), tensions raciales accumulées, crise diplomatique avec plusieurs alliés historiques. Mais c’est surtout la politique de la communication permanente et le dénigrement systématique des opposants qui marquent cette période. Dans l’opinion, Trump reste clivant : il déchaîne autant qu’il enthousiasme la population, dessinant des lignes de fracture profondes au sein de la société américaine.
Malgré une forte base de soutien, il a échoué à se faire réélire en novembre 2020, face à Joe Biden. Trump refuse de reconnaître sa défaite, crie à la fraude électorale et alimente une dynamique complotiste sans précédent.
L’assaut du Capitole : le choc du 6 janvier 2021

Lorsque Joe Biden a remporté l’élection de 2020, Donald Trump a initié de multiples recours en justice, tous rejetés faute de preuves valables. Il appelle alors ses plus fervents partisans à se rassembler à Washington DC le 6 janvier 2021, jour où le Congrès doit certifier les résultats de l’élection. Ses mots sont explicites : il demande à la foule de « sauver l’Amérique » et de « marcher » sur le Capitole pour bloquer la certification.
Des milliers de manifestants, animés par la conviction que le scrutation a été « volé », prennent d’assaut le bâtiment. Les images choquent le monde entier : bris de vitrines, affrontements avec les forces de l’ordre, élus barricadés pour éviter la confrontation. L’événement se solde par cinq morts, dont un policier. Il est considéré comme une tentative de coup d’État par de nombreux spécialistes, puisque l’objectif avoué était d’empêcher une procédure démocratique.
Si ce putsch n’a pas abouti, il révèle à quel point la parole présidentielle peut radicaliser un parti de l’opinion. L’attaque contre le Congrès, institution clé de la démocratie américaine, est vécue comme une rupture dans l’histoire politique récente des États-Unis. Joe Biden devient bien président le 20 janvier 2021, mais Trump quitte la Maison-Blanche avec la promesse de revenir.
Le retour de Trump en 2025 : l’ère d’une radicalisation assumée
 L’élection de 2024 voit donc la revanche de Donald Trump. Ses partisans n’ont jamais vraiment adhéré à la légitimité de la présidence Biden, et le contexte de polarisation reste très élevé. Le 20 janvier 2025, Trump retrouve le Bureau ovale, porteur de promesses plus radicales encore qu’en 2017.
L’élection de 2024 voit donc la revanche de Donald Trump. Ses partisans n’ont jamais vraiment adhéré à la légitimité de la présidence Biden, et le contexte de polarisation reste très élevé. Le 20 janvier 2025, Trump retrouve le Bureau ovale, porteur de promesses plus radicales encore qu’en 2017.
Dès le début de son mandat, il prononce une phrase lourde de sens : « Nous ne laisserons plus l’Amérique être exploitée ! » (Nous ne laisserons plus les États-Unis se faire exploiter !). Cette injonction donne le ton. L’administration s’emploie, dans les jours qui suivent, à licencier massivement des fonctionnaires désignés comme « déloyaux » ou trop liés à l’établissement. Les nouvelles nominations ne tiennent plus vraiment compte de la compétence ou de l’expérience : seule la loyauté envers Trump prime.
Le président enclenche par ailleurs une vaste campagne d’expurgation des bibliothèques publiques. Des ouvrages entiers, jugés « contraires » à la vision du pouvoir, sont bannis. Les protestations se heurtent à un discours musclé sur la nécessité de protéger les valeurs américaines « authentiques ». Dans les établissements scolaires et universitaires, la pression s’accroît : tout enseignement perçu comme trop critique ou trop inclusif est menacé.
La presse demeure la cible majeure : en février 2025, plusieurs journalistes réputés pour leurs enquêtes sur Trump se voient interdire l’accès à la Maison-Blanche. D’autres subissent des campagnes de dénigrement systématiques. Le président va jusqu’à déclarer que cela ne le dérangerait pas si des personnes « ouvraient le feu » sur les journalistes se rendant à ses réunions. Ce climat, mêlant intimidation et violence verbale, s’apparente aux pratiques de milices fascistes du début du XXe siècle, même si Trump ne dispose pas obligatoirement d’une force paramilitaire.
Loyauté absolue et subordination de la compétence

Il supervisera désormais des agences telles que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la Food and Drug Administration (FDA), les National Institutes of Health (NIH) et les Centers for Medicare and Medicaid Services.
Kennedy sera également chargé de superviser le secteur de la santé aux États-Unis, qui comprend la sécurité alimentaire, les produits pharmaceutiques, la santé publique et les vaccins.
L’un des changements majeurs entre le premier et le deuxième mandat de Trump réside dans sa volonté de ne s’entourer que de personnalités entièrement dévouées à son respect. Les conseillers ou secrétaires d’État ayant manifesté la moindre indépendance d’esprit en 2017-2021 sont mis à l’écart. À la manière d’un chef autocratique, Trump revendique une allégeance totale.
Cette obsession de la loyauté rappelle les régimes fascistes ou nazis, où les postes clés étaient occupés par des proches du chef, nommés non pas pour leurs compétences, mais pour leur capacité à exécuter sans discuter de la volonté suprême. Mussolini avait ses « hiérarques fascistes » totalement à sa botte, tandis qu’Hitler confiait des fonctions de premier plan à des hommes comme Goebbels, Göring ou Himmler, choisis pour leur fanatisme, malgré parfois un manque d’expertise administrative.
Alliances stratégiques avec X et Meta : la mainmise sur les réseaux sociaux
Il n’existait pas de Twitter ou de Facebook en 1922 ou 1933, mais ces plateformes jouent un rôle déterminant au XXIe siècle. Un fait nouveau vient d’apparaître dans le deuxième mandat de Trump : l’appui direct d’Elon Musk, devenu propriétaire de X (ex-Twitter), et celui de Mark Zuckerberg, fondateur et dirigeant de Meta (Facebook).
Officiellement, Musk et Zuckerberg se présentent comme des partisans de la liberté d’expression, visant à laisser s’exprimer toutes les sensibilités. Dans les coulisses, ils nouent des alliances avec la Maison-Blanche, offrant à Trump un ascendant redoutable sur la diffusion des informations. Les algorithmes de recommandation présentent désormais les contenus pro-gouvernementaux, tandis que les comptes qui ont été perçu trop critiques subissent des réductions de visibilité ou des suspensions temporaires.
Cette situation confère au président un pouvoir de propagande inédit. Là où Hitler ou Mussolini devaient s’assurer du contrôle de la presse écrite et des ondes radio, Trump jouit d’un accès direct, en temps réel, à des centaines de millions d’utilisateurs. Ce monopole informel sur la parole publique affaiblit encore davantage les médias traditionnels, déjà malmenés par les restrictions d’accès à la Maison-Blanche et les menaces verbales réitérées contre les journalistes.
Contrôle de la culture, de l’enseignement et de la science
En plus des purges dans l’administration et de la censure dans les bibliothèques, la nouvelle administration Trump se montre déterminée à étendre son contrôle à la recherche scientifique. L’exemple le plus frappant concerne le CDC (Centers for Disease Control and Prevention), institution de santé publique de référence aux États-Unis.
Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 a déjà révélé d’importantes divergences entre la présidence Trump et les scientifiques, la seconde administration impose plusieurs niveaux de surveillance sur les publications du CDC. Les déclarations officielles, les rapports de recherche et même les statistiques passées font l’objet d’un examen minutieux. Tout écart par rapport à la vision du gouvernement est sévèrement réprimandé ou dissimulé.
Selon certaines sources internes, des mots-clés sont désormais proscrits dans les communications publiques, et les études jugées trop alarmistes pour l’économie ou la réputation du président subissent des retards de publication. L’objectif serait de façonner une « science officielle » parfaitement alignée sur la rhétorique de la Maison-Blanche, quitte à sacrifier la rigueur scientifique.
Cette mainmise sur la recherche vient compléter le dispositif de censure déjà à l’œuvre dans la culture et l’éducation. Les parallèles historiques abondent : le régime fasciste de Mussolini avait imposé une « italianisation » forcée des savoirs et une exaltation des théories raciales mal étayées, tandis que l’Allemagne nazie glorifiait le concept de « science allemande » et purgeait les laboratoires de ses éléments « indésirables ».
Comparaisons et divergences : un inquiétant écho de l’Histoire
Les points communs observés entre Mussolini, Hitler et Trump ne signifient pas que le scénario historique va se reproduire à l’identique. Les époques, les contextes, les mentalités différentes. Néanmoins, certaines dynamiques se retrouvent :
- Exploiter la colère populaire après une crise ou une frustration collective (l’Italie déçue de 1919, l’Allemagne humiliée de 1918, l’Amérique polarisée du XXIe siècle).
- Se construire un culte du chef : Duce, Führer, président « sauveur ».
- Réprimer ou contourner les contre-pouvoirs : interdiction ou censure de la presse, licenciement d’opposants, manipulation des élections ou mise en cause de leurs résultats.
- Désigner des boucs émissaires : socialistes, juifs, élites politiques, médias, scientifiques, etc.
- Contrôler la culture, l’enseignement, la recherche scientifique pour imposer une vision unilatérale et consolider la légitimité du régime.
Il existe cependant des divergences notables :
- L’accès aux nouvelles technologies, et surtout aux réseaux sociaux, modifie radicalement la vitesse et la portée de la propagande.
- Les États-Unis disposent d’une tradition constitutionnelle plus ancienne que l’Allemagne de Weimar ou l’Italie libérale. Des freins et contrepoids existent encore, même s’ils s’érodent.
- La dimension explicite raciale et antisémite qui caractérisait le nazisme ne se retrouvait pas, dans la forme, au sein du trumpisme, même si un discours xénophobe, notamment à l’égard des immigrés, persiste.
Que nous réserve l’avenir ?
La question cruciale demeure : les institutions américaines et la société civile réagiront-elles suffisamment tôt pour empêcher une dérive irréversible ? Sous Mussolini, la monarchie et les libéraux ont capitulé, convaincus que le fascisme n’était qu’une brève parenthèse. En Allemagne, les conservateurs ont cru qu’Hitler serait un pion utile, avant de le voir démanteler toute opposition.
Dans la situation actuelle des États-Unis, l’exécutif bénéficie d’une large assise parlementaire, et la Cour suprême a déjà basculé idéologiquement suite aux nominations antérieures de Trump. Les médias, censés jouer un rôle de contre-pouvoir, peinent à faire leur travail si la Maison-Blanche leur ferme les portes et si les réseaux sociaux les marginalisent grâce à des algorithmes orientés.
La censure qui touche désormais le CDC révèle que la politique et l’idéologie peuvent l’emporter sur la science, et que même la santé publique n’échappe pas aux pressions gouvernementales. Les bibliothèques épurées, les universitaires intimidés, les journalistes menacés… tout cela brosse le tableau d’une Amérique en train de rétrécir l’espace de la liberté d’expression.
La population en désaccord avec Trump, ainsi qu’une parti de la classe politique, s’interroge sur la manière de réagir. Si les manifestations pacifiques se multiplient, risquent-elles de dégénérer ? Les législateurs peuvent-ils engager des procédures pour limiter l’emprise du président, ou craignent-ils, au contraire, de perdre leur poste s’ils s’opposent à une base électorale trumpiste toujours fervente ?
Conclusion
Les histoires de Mussolini et d’Hitler rappellent à quel point la démocratie peut se révéler fragile lorsque des hommes politiques arrivent à instrumentaliser la frustration populaire et les failles institutionnelles. De l’Italie des années 1920 à l’Allemagne de 1933, on voit des gouvernements légalement investis se transformer en dictatures en un temps record. Les comparaisons avec Donald Trump peuvent sembler outrancières, mais elles révèlent néanmoins des mécanismes similaires : construction d’une figure providentielle, répression de l’opposition, usage intensif de la propagande, contrôle accumulé de l’enseignement et de la recherche, marginalisation des médias.
Depuis le 20 janvier 2025, le deuxième mandat de Trump est marqué par une radicalité décuplée. L’éviction de centaines de fonctionnaires, la censure des bibliothèques, l’intimidation des journalistes, l’allégeance forcée des réseaux sociaux et la mise sous tutelle de la science, symbolisée par la tutelle imposée au CDC, sont autant de signaux inquiétants. Cette chronique ne prétend pas annoncer une catastrophe inévitable. Elle invite plutôt à réfléchir aux enseignements de l’Histoire et au rôle déterminant de la mobilisation citoyenne.
Si la marche sur Rome, l’arrivée d’Hitler à la chancellerie ou l’assaut du Capitole ont pu, à leur époque, être minimisés, ils se sont révélés être les prémices de bouleversements bien plus profonds. Il appartient aujourd’hui aux Américains, et plus largement aux défenseurs de la démocratie dans le monde, de tenir compte de ces précédents. Préserver la liberté de la presse, la neutralité de la recherche scientifique et la pluralité politique, ce n’est pas seulement défendre des principes abstraits : c’est refuser la répétition de schémas qui, plus d’une fois, ont mené au pire.
Je vous encourage à partager et à émettre votre propre opinion sur le sujet. Je vous le promets, Donald ne le saura pas ! 😬
Rejoignez-nous !
Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.