
Marine Le Pen a reçu, le 31 mars 2025, une sentence qui a fait grand bruit: cinq années d’inéligibilité avec exécution immédiate et une peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux fermes sous bracelet électronique pour détournement de fonds publics. Cette décision fait suite à une enquête approfondie menée par des juges spécialisés dans les affaires de corruption. Selon les enquêteurs, elle aurait utilisé des subventions publiques pour financer en partie des activités partisanes. Aux yeux de ses partisans, cette condamnation relève d’un complot orchestré par l’élite politique, une manœuvre visant à empêcher Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027. Aux yeux des magistrats, l’affaire s’appuie sur des preuves solides et sur des textes de loi qui, dans la plupart des démocraties, sont censés s’appliquer à tous, quelles que soient les ambitions personnelles ou la popularité de l’accusé. Nombre d’observateurs s’imaginaient alors que cette décision signerait la fin de son parcours politique. Pourtant, si l’on en croit ses soutiens, il ne serait pas question pour elle de tirer un trait sur l’élection présidentielle de 2027. Son discours rappelle furieusement les stratagèmes de Donald Trump, qui avait su transformer ses nombreux déboires judiciaires en une épopée triomphale aux États-Unis.
Marine Le Pen n’a pas tardé à dénoncer la décision, évoquant une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Elle y voit l’œuvre de « gauches militantes » prêtes à tout pour empêcher sa candidature. Si ces affirmations suscitent l’adhésion dans une partie de l’électorat, une autre frange de la population y voit une remise en cause préoccupante de la séparation des pouvoirs. En se posant en victime d’un système judiciaire corrompu, Le Pen défie ouvertement le principe selon lequel la justice est censée être impartiale et autonome.
L’empreinte de Donald Trump sur la stratégie de Marine Le Pen
Les paroles de Marine Le Pen rappellent avec insistance la rhétorique employée par Donald Trump, surtout depuis le début de ses péripéties judiciaires. Trump a longtemps clamé qu’il était la cible d’une « chasse aux sorcières », destinée à entraver son ascension politique. Condamné pour abus sexuel dans une affaire médiatisée, poursuivi pour 34 délits de falsifications comptables, l’ancien président américain a pourtant remporté l’élection du 5 novembre 2024, se hissant une deuxième fois à la Maison-Blanche. Son succès électoral, malgré ses dossiers juridiques, a montré que les électeurs ne sont pas toujours dissuadés par des accusations criminelles, lorsque le discours du candidat parvient à éveiller leurs passions et à nourrir leur méfiance à l’égard des institutions.
Marine Le Pen semble donc reprendre à son compte une stratégie de communication axée sur la dénonciation des élites et la valorisation de la « volonté populaire ». Il ne s’agit pas simplement de contester la légitimité du verdict, mais plus fondamentalement de décrédibiliser l’autorité de l’institution judiciaire. En présentant le système comme étant manipulé par ses opposants, elle cherche à mobiliser la colère et la solidarité de ses sympathisants, prêt·e·s à défendre leur candidate contre ce qu’ils perçoivent comme une injustice flagrante.
La construction d’une image de martyr politique
Dans l’imaginaire collectif, un leader que la justice veut « abattre » peut devenir un héros populaire. C’est la logique qu’ont comprise ces figures politiques lorsqu’elles crient au complot ou à la persécution. Le parallèle entre Trump et Le Pen se tisse sur la revendication d’une injustice subie, d’un pouvoir judiciaire « à la solde » de l’ennemi politique. Aux États-Unis, Trump a sans cesse réaffirmé que ses déboires juridiques relevaient d’une manœuvre orchestrée par les démocrates ou par les médias. Ce discours a résonné auprès de ceux qui se méfient profondément des institutions fédérales, soupçonnées de partialité ou d’être gangrenées par des « intérêts mondialistes ». Chez Marine Le Pen, la cible est différente : ce sont les « gauchistes » et certains juges prétendument politisés qui auraient voulu se débarrasser d’une concurrente gênante en vue de 2027.
Le mécanisme derrière cette stratégie est bien connu : plus on accuse un système d’être injuste, plus on invite ses partisans à rejeter les décisions émanant de ce système, au profit d’une légitimation par l’émotion collective ou par des arguments populistes. En France, le cheminement n’est pas identique à celui des États-Unis, mais il peut suivre un schéma comparable lorsque l’opinion se polarise autour de la figure d’un leader en difficulté judiciaire. Certains militants ressentent un devoir de défendre la personne qu’ils soutiennent, y voyant une façon de protéger leurs propres convictions politiques.
Le déni des faits et la quête de la légitimité électorale
Marine Le Pen, tout comme Donald Trump, renverse la problématique juridique en la transformant en question de souveraineté populaire. Autrement dit, pourquoi laisser la justice « dicter » l’avenir politique d’un candidat alors que, selon elle, seul le peuple a le pouvoir légitime de choisir ? C’est cette inversion qui explique pourquoi ils nient ou minimisent leurs propres actes répréhensibles, et préfèrent se focaliser sur le caractère prétendument antidémocratique du jugement. Le but est d’ancrer l’idée que les urnes sont un référendum non seulement sur un programme politique, mais également sur la validité même des poursuites judiciaires.
Trump a multiplié les rassemblements publics, en marge des tribunaux, pour s’adresser directement à ses électeurs et se présenter comme un homme du peuple persécuté par l’establishment. Marine Le Pen, de son côté, tente de reproduire ce scénario : elle soutient qu’il n’appartient pas aux juges de décider si elle doit être écartée de la course à l’Élysée. Cette posture trouve un écho chez celles et ceux qui s’estiment déjà marginalisés par les grands partis ou qui nourrissent une méfiance envers le système judiciaire. Ainsi, la candidate peut se présenter comme l’instrument d’une volonté collective, au-dessus de la loi, qu’elle juge politisée.
L’impact sur la démocratie et la confiance dans les institutions
Les effets de ce déni systématique ne se limitent pas à la sphère politique immédiate : ils influencent plus largement la confiance du public dans les institutions qui régulent la société. Quand une personnalité de premier plan conteste la légitimité des juges et laisse entendre que seules les élections devraient prévaloir sur la loi, c’est toute l’architecture démocratique qui se retrouve menacée. En démocratie, les tribunaux constituent un contre-pouvoir essentiel. Leur rôle est de faire respecter les règles communes, indépendamment de l’identité ou de la popularité des individus concernés. Si ce rôle est perçu comme partisan ou corrompu, la société glisse alors vers un relativisme juridique dangereux.
L’exemple de Donald Trump, réélu malgré ses affaires judiciaires, illustre la manière dont une partie de l’électorat peut adhérer à l’idée d’une justice manipulée. Cette perception s’amplifie grâce aux réseaux sociaux, où la défiance envers les instances officielles se propage rapidement. Marine Le Pen sait pertinemment que la campagne en ligne est un champ de bataille décisif. Elle y explique que sa condamnation n’est qu’un instrument de sabotage, espérant renforcer le lien émotionnel avec ses sympathisants et agrandir la fracture entre ceux-ci et l’institution judiciaire. Si la méfiance s’étend, le risque est grand de voir la loi perdre encore davantage de son autorité face à la popularité.
L’appel systématique : arme de la prolongation médiatique
Marine Le Pen a déjà annoncé qu’elle ferait appel de sa condamnation, contestation qui pourrait bloquer, suspendre ou au moins retarder les effets pratiques de sa peine dans certains scénarios juridiques. Cet appel permet d’alimenter le débat public et de maintenir l’affaire dans l’actualité. Pendant la durée de la procédure, elle conserve la possibilité de clamer son innocence et de se présenter comme une femme politique injustement persécutée. Cette tactique fait écho à la volonté de Trump d’utiliser chaque rebondissement judiciaire comme une tribune pour présenter ses arguments et activer la solidarité de ses partisans.
Nier les faits, dans ce contexte, devient presque secondaire : l’essentiel est de transformer le procès en un théâtre médiatique où la victime supposée lutte contre un système qui la condamne sans fondement, selon elle. Ce récit dramatique captive un public plus large que les seuls militants, car chacun peut se sentir interpellé par l’idée d’une justice qui sortirait de son rôle pour faire la chasse à un candidat. L’appel judiciaire devient alors un outil politique qui prolonge la confrontation au tribunal, tout en donnant l’occasion de renforcer une image de résistance.
Quand la condamnation nourrit la popularité
Un paradoxe émerge : alors même qu’une condamnation judiciaire devrait être un coup fatal pour les ambitions d’une personnalité politique, elle peut se transformer en bénéfice symbolique, voire électoral. Les soutiens se font plus bruyants, galvanisés par un sentiment d’injustice. Le grand public, de son côté, voit l’affaire rebondir dans la presse et sur les réseaux sociaux, s’interrogeant parfois davantage sur la portée politique que sur la réalité des faits. Dans le cas de Donald Trump, l’enchaînement des inculpations n’a pas empêché nombre d’électeurs de le considérer comme le meilleur défenseur de leurs intérêts. Marine Le Pen, en adoptant un discours similaire, espère sans doute tirer avantage d’une polarisation de l’opinion : être aimée avec passion ou détestée avec force, mais jamais ignorée.
Il est également frappant de constater que la victimisation politique peut rendre secondaire le sujet précis de la condamnation. Que s’agisse de détournement de fonds publics, de fraude, de corruption ou d’abus sexuel, l’attention se déplace vers la question de savoir si la personne a été « injustement traitée ». Cette transposition du débat détourne du fond de l’accusation, parfois complexe à saisir dans ses détails juridiques, pour se concentrer sur l’idée générale que « les puissants veulent détruire la candidate ». Ainsi, le récit victimaire risque d’éclipser la gravité des actes reprochés.
Les risques pour la présidence de 2027 et au-delà
D’un point de vue purement légal, la condamnation de Marine Le Pen la prive, en théorie, de toute éligibilité pendant cinq ans. Toutefois, la durée de la procédure d’appel ou de tout autre recours juridique peut influencer le calendrier. Dans certains cas, les avocats parviennent à repousser l’application de la sanction jusqu’à ce que tous les degrés de juridiction aient été épuisés. Si la candidate obtient gain de cause en appel, la situation pourrait se renverser en sa faveur et nourrir le sentiment d’une revanche contre le système judiciaire. Si, au contraire, la décision est confirmée, cela pourrait alimenter davantage encore le discours d’une justice supposément « inféodée » à un pouvoir en place, ce qui pourrait paradoxalement renforcer la base militante.
En 2027, la course à l’Élysée pourrait alors se dérouler dans un climat de méfiance extrême à l’égard des institutions, en particulier si Marine Le Pen parvient à maintenir sa notoriété malgré l’inéligibilité et à faire de sa situation une affaire d’honneur national. C’est un défi pour la démocratie et les organes juridictionnels français, car la campagne pourrait se cristalliser autour de la question « loi vs. volonté populaire ». Cette opposition tend à délégitimer le rôle neutre de la justice, ce qui pourrait avoir des conséquences durables sur la perception des institutions républicaines.
La comparaison transatlantique et ses limites
Malgré les similarités de style et de discours, il convient de noter que la France et les États-Unis ne fonctionnent pas de la même manière au niveau institutionnel. Le système présidentiel américain confère au chef d’État des pouvoirs particulièrement étendus, et une partie de l’électorat républicain est depuis des années en rupture de confiance avec le gouvernement fédéral. En France, la Ve République accorde aussi d’importantes prérogatives au président, mais le contexte social et culturel diffère. Les Français accordent traditionnellement plus de crédit à leurs services publics et conservent une certaine attente envers l’impartialité de la magistrature.
Toutefois, la montée d’un sentiment populiste fait vaciller ces repères. Au fil des élections, l’idée selon laquelle les « élites » ou la « classe politique » seraient déconnectées du peuple a nourri des mouvances qui trouvent un écho dans le discours de Le Pen. Lorsqu’une affaire judiciaire sanctionne une personnalité d’envergure, ce même discours propose une clé de lecture : c’est la preuve que l’establishment cherche à briser le porte-voix du peuple. Trump a exploité ce ressort avec succès, et Marine Le Pen tente de l’adapter au contexte français.
Vers un choc entre État de droit et populisme
Au bout du compte, la situation de Marine Le Pen et celle de Donald Trump révèlent un choc entre deux conceptions de la démocratie : d’un côté, la primauté de la loi, garante de l’égalité et de la protection contre l’arbitraire ; de l’autre, la volonté de voir la décision populaire l’emporter sur toute autre considération, y compris judiciaire. Cette tension n’est pas nouvelle, mais elle s’est exacerbée à l’ère des réseaux sociaux et des discours populistes. L’enjeu pour les institutions est de réaffirmer leur légitimité et de montrer que la justice n’est pas l’instrument d’un camp politique.
Il appartient aussi aux citoyens d’y voir clair. Soutenir un dirigeant, c’est accepter qu’il exerce le pouvoir dans le respect des lois. S’il prétend que les lois ne devraient pas s’appliquer à lui, le pacte démocratique se trouve fragilisé. La popularité ne peut être l’unique gage de crédibilité face à un crime ou à un délit. Les épisodes récents aux États-Unis et en France montrent que l’on glisse aisément de la défense d’une cause politique à la contestation globale du système judiciaire, entamant la cohésion d’une société.
Rejoignez-nous !
Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des informations intéressantes et des mises à jour dans votre boîte de réception.



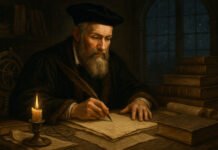
















Si vous avez visionné son grand rassemblement, le 6 avril, à Paris, vous aurez constaté qu’elle ne veut pas simplement imiter les déclarations et les techniques de Donald Trump afin de saper la justice et que tous sont pervertis sauf elle, la victime. Elle le fait vraiment dans un discours, identique à se que faisait Donald Trump afin de galvaniser la foule venue l’entendre. https://www.youtube.com/watch?v=HX1xymc2YAc